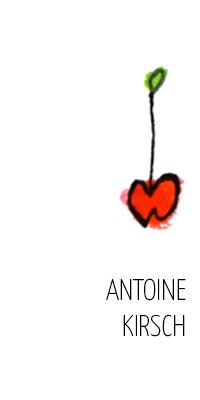Il a fait très beau, il y avait plus de 400 mille personnes. Autre ministre de Louis XVI, Antoine François Bertrand de Molleville s'attacha également à « l'énigme Robespierre » dans son Histoire de la Révolution de France, parue entre l'an IX et l'an XI. Cette offensive fut appuyée par le nouveau journal de Camille Desmoulins, Le Vieux Cordelier, qui obtint un grand succès. La Commune de Paris avait fait sonner le tocsin et s'apprêtait à l'insurrection, mais Robespierre tergiversa à donner l'ordre du soulèvement. En lieu et place, il demanda que des assemblées extraordinaires fussent convoquées dans toutes les sections « pour délibérer sur les moyens de dénoncer à la France entière la trame criminelle des traîtres ». Ces paroles insignifiantes, noyées dans la foule, mais que Robespierre semble avoir entendues, traversèrent l'histoire et arrivèrent jusqu'aux oreilles de Jules Michelet qui, viscéralement hostile à Robespierre, ne vit plus en lui que le Pontife de l'Être suprême, ne trouvant pas de meilleur moyen pour le discréditer. Arrestation des robespierristes à l'Hôtel de Ville, le 10 thermidor. De même, il lui reconnaît une supériorité d'ordre esthétique dans l'éloquence et affirme « qu'il faut chercher peut-être dans [ses] discours (...) presque tout ce qu'il y avait de spiritualisme et de sentiments humains dans l'éloquence conventionnelle ». Il participa à plusieurs concours académiques. Le 13 janvier, alors que la lettre de Dartigoeyte n'était pas encore arrivée, Musset et Delacroix, à Versailles, écrivirent au Comité : « Pressez le Comité d’instruction publique d’organiser promptement l’éducation nationale, l’instruction publique, les fêtes. Le même jour, Robespierre entra avec Léonard Bourdon à la Commission d'instruction publique, en remplacement de Jeanbon Saint-André et de Saint-Just. Successivement choisi pour représenter l'assemblée des habitants non corporés de la ville d'Arras (23-25 mars) puis celle des électeurs du Tiers état de la ville (26-29 mars), il fut élu, le 26 avril 1789, par l'assemblée électorale d'Artois, parmi les huit députés du Tiers état. Voir, Sur les conditions de la naissance de Robespierre, voir, Inscrits bourgeois, des Robespierre portaient, depuis la fin du, « il disparut définitivement en 1772 et mourut à Munich le 6 novembre 1777 ». Quoi qu'il en soit, Robespierre témoignait, à travers ce texte, de son souci de trouver une solution légale à la crise constitutionnelle, en laissant aux députés le soin de se prononcer, conformément à la constitution, qui prévoyait au chapitre II, section première, plusieurs circonstances aboutissant à « l'abdication expresse ou légale du roi », notamment l'article 6, qui explique que, « si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise, qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté[97]. Il participa à l’élaboration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ainsi qu’à la première constitution française en 1791. Le Comité fit arrêter les dirigeants cordeliers dans la nuit du 13 au 14 mars. » Cette lettre était la première d'une longue série. Robespierre se rendit finalement devant la Convention, où il mit au jour les attaques dont il était victime et proposa de modifier la composition des comités de salut public et de sûreté générale, et de subordonner le second au premier, le 8 thermidor (26 juillet). Presque en même temps, fin mai et courant juin, la question du régime à instaurer commençait à se poser. ». Le 9 Thermidor, empêché de parler par ses adversaires, il est arrêté avec son frère Augustin et ses amis Couthon, Saint-Just et Le Bas. Robespierre avait lui-même présenté, le 24 avril, un projet de déclaration des droits (précédé par un discours sur la propriété), prolongé le 10 mai par un discours sur la constitution future[173],[174], dont l'influence sur le projet final a fait l'objet de discussions[175],[176]. Si « Robespierre ne figura pas au cabaret du Soleil-d'Or avec les principaux moteurs d'insurrection qui bientôt allaient entraîner les masses populaires à l'assaut des Tuileries », avec son discours du 29 juillet, « il fit mieux, il mena les idées au combat, et, gardien jaloux des principes décrétés en 1789, il chercha, avant tout, à empêcher la Révolution d'aboutir à la dictature ou à l'anarchie ». Le 25 décembre 1913 a été inaugurée à Saint-Ouen une statue en plâtre, qu'on se proposait « de couler un jour en bronze », projet qui n'a jamais vu le jour[351]. En 1790, un certain Pierre Villiers, officier de dragons et auteur dramatique, lui servit durant sept mois de secrétaire[54]. Choisi le 3 juin suivant par les députés du club des Jacobins comme leur candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale[53] pour la période du 6 au 21 juin, il se vit opposer le député Luc-Jacques-Édouard Dauchy, soutenu par la majorité modérée. De novembre 1790 à septembre 1791, il joua un rôle de premier plan dans les débats sur l'organisation des gardes nationales[48]. Or Louis-Sébastien Mercier était l'un des soixante-treize détenus girondins que Robespierre avait, en octobre 1793, sauvé d'une comparution devant le Tribunal Révolutionnaire. Ces historiens font remarquer que la chute de Robespierre, le 9 Thermidor, coïncide avec l'arrêt des mesures sociales qu'il avait prises en faveur des pauvres (la loi du maximum général par exemple, qui contrôlait le prix du pain et du grain), et le triomphe du libéralisme économique. Le 3 juin 1793 au club des Jacobins, les députés Bourdon de l'Oise, Chabot, Robespierre, Jeanbon Saint-André, Legendre, Maure et d'autres sociétaires reçoivent avec enthousiasme une délégation de Noirs, notamment la vieille femme Jeanne Odo de 114 ans. Mais le 3 floréal an II-22 avril 1794, tous les cinq ainsi que Prieur de la Côte d'Or signent pour les petites Antilles françaises - Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie - la nomination d'un troisième commissaire, Sijas, sur demande des deux autres, Victor Hugues et Pierre Chrétien. L'Incorruptible apparaît lui-même dans le chapitre XXVI, peu avant le 9-Thermidor. Il est amené en charrette sur la place de la Révolution (ancien nom de la place de la Concorde) en compagnie de 21 de ses partisans, dont son frère et Saint-Just, pour y être guillotiné. Parmi ses premiers contacts, on compte Jacques Necker, qui le reçut à dîner chez lui en mai. Maximilien François Marie Isidore de Robespierre (n.6 mai 1758 – d. 28 iulie 1794); (După Calendarul Republican data decesului este 10 thermidor an II). Ce démantèlement du système de l'an II, et particulièrement de l'appareil répressif n'aboutit pas, cependant, à la mise en accusation de tous ceux qui avaient organisé la Terreur et en avaient largement profité en mettant la main sur les biens des nobles et des banquiers exécutés, ces derniers chargeant Robespierre de tous leurs méfaits et n'hésitant pas à falsifier les documents historiques. Enfin, le 28 mai 1792, le ministre de la guerre girondin Servan demanda devant l'Assemblée que « la nation se lève tout entière » pour défendre le pays, avant d'appeler, le 8 juin, chaque canton à envoyer cinq fédérés vêtus et équipés, soit 20 000 hommes, à Paris, afin de prêter un serment civique. De surcroît, le 18 janvier 1792, il insère l'affaire avignonnaise dans la question de la guerre d'attaque qui l'oppose à Brissot : à l'instar des autres contre-révolutionnaires de l'intérieur, ceux d'Avignon sont plus dangereux que les émigrés de Coblentz. Quant à la deuxième phrase écrite en privé pendant la crise des factions, elle peut aussi lui avoir été à nouveau influencée par Janvier Littée, mais elle fut de toute façon supprimée par Saint-Just quand il mit au propre les notes de son ami contre les Dantonistes pour son réquisitoire du 11 germinal an II (31 mars 1794), sans que leurs relations en fussent troublées. Il est blessé à la mâchoire dans des circonstances incertaines. « Édition définitive » (nouvelle édition augmentée). Selon Mathiez, quand Marc-Antoine Jullien de Paris, envoyé en mission par le comité de salut public dans les départements maritimes, l'alerta sur le comportement de Jean-Baptiste Carrier à Nantes[194] et de Jean-Lambert Tallien à Bordeaux, il demanda leur rappel, de même qu'il réclama celui de Paul Barras et de Louis Fréron, en mission dans le Midi, de Stanislas Rovère et François-Martin Poultier, qui organisaient dans la Vaucluse les bandes noires pour s'emparer des biens nationaux, de Joseph Le Bon, dénoncé pour ses exactions en Artois, et de Joseph Fouché, responsable des mitraillades à Lyon. Seul avec mon âme, comment aurais-je pu soutenir des travaux qui sont au-dessus de la force humaine, si je n’avais point élevé mon âme. En tant que titulaire de cette société, il chanta des couplets et composa des vers « anacréontiques », notamment un Éloge de la Rose écrit en réponse au discours de réception d'un nouveau membre[35]. La popularité du général était telle que l’Assemblée n’osa prendre aucune mesure contre lui, malgré les efforts des Girondins[86]. Deux jours plus tard, le 25, Brissot menaçait les républicains du glaive de la loi : « Si ce parti de régicides existe, s’il existe des hommes qui tendent à établir à présent la République sur les débris de la Constitution, le glaive de la loi doit frapper sur eux comme sur les amis actifs des deux Chambres et sur les contre-révolutionnaires de Coblentz[91]. Selon les Mémoires posthumes de Jacques Pierre Brissot, témoignage rejeté par l'éditeur Gérard Walter comme invraisemblable pour des raisons chronologiques, il aurait été un temps clerc chez le procureur Nolleau fils, où le futur girondin l'aurait croisé[26]. À partir d'avril deux membres du comité de salut public en mission dans les ports de l'Ouest de la France, Prieur de la Marne et Jeanbon Saint-André, agirent en ce sens à Nantes et à Brest[251],[252]. En revanche, selon Gérard Walter, on trouve des traces de lui à Arras jusqu'en mars 1766, puis de nouveau en octobre 1768. Cet apport documentaire favorisa un renouvellement historiographique, avec l’Histoire des Girondins (1847) d'Alphonse de Lamartine[306], l’Histoire de la Révolution française (1847-1853) de Jules Michelet et celle de Louis Blanc (1847-1855), qui firent toutes de Robespierre « le centre de leurs investigations », même si seul Louis Blanc lui était plus nettement d'emblée favorable[307]. Le 5 fructidor (22 août), François-Pierre Deschamps, aide de camp d'Hanriot, est à son tour guillotiné[5]. Membre du club des Jacobins dès ses origines, il en devient progressivement l'une des figures de proue. Il fut l’un des rares défenseurs du suffrage universel et de l'égalité des droits, s'opposant au décret dit du « marc d'argent » qui instaurait le suffrage censitaire, le 25 janvier 1790[44] et défendant le droit de vote des comédiens et des juifs[n 1]. Contre le nommé Jacques Dubois, maquignon, demeurant au village de St. Hilaire, https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/16p4, https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/16qf, https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/16rr, Ernest Hamel, livre VIII, chap. Jump to navigation Jump to search. Pourtant, signale Roger Bellet, la hargne de Vallès à l'égard de « Rousseau n'est pas automatiquement réversible sur Robespierre » ; son déisme « voulait sans doute être à usage populaire », celui d'une religion non ecclésiastique, Vallès pouvait partager sa critique du « philosophisme », sa critique d'un « monde de scolastique philosophique et émeutier » est plus proche de Robespierre que d'Hébert[326]. » Le lendemain, Jean-Marie Roland de la Platière, après avoir présenté un tableau de la situation de Paris, demanda à lire les pièces justificatives de son mémoire, parmi lesquelles se trouvait une lettre qui laissait entendre que Robespierre aurait préparé une liste de proscription[137]. Maximilien de Robespierre est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants et il perd sa mère à l'âge de six ans. 33 edition, in French / français Le 31 mai, il demeura silencieux jusqu'à ce que fût proposée la mise aux voix du rapport que Bertrand Barère avait présenté au nom du comité de salut public, dans lequel il se bornait à demander la suppression de la commission des Douze. On parle souvent de « culte de l'Être suprême », comme si le décret du 18 floréal instituait une nouvelle religion, voire un culte de la personnalité. Au contraire, pour Ernest Hamel, il n'y avait alors encore aucune divergence d'opinion entre Robespierre et Carnot, avec lequel il avait été lié d'amitié à Arras, et les paroles prononcées aux Jacobins le soir du 11 août[185], qui ont pu selon lui être infidèlement rapportées, ne l'empêchèrent pas, le 25 septembre, de demander à la Convention de déclarer que le comité avait bien mérité de la patrie[186]. Robespierre vit dans cette dernière mesure, à tort de l'avis de Michel Vovelle (même s'il considère que les Girondins se sont eux-mêmes trompés « sur ce qu'allaient être ces « fédérés » »)[84], une manœuvre pour réduire l'agitation démocrate de la capitale. Son coup de pistolet lui fracture complètement la mâchoire et la joue est percée par des éclats d'os. Son discours contre la loi martiale du 21 octobre 1789 en fit l'un des principaux animateurs de la Révolution et la cible d'attaques de plus en plus acharnées de ses adversaires, particulièrement de son ancien professeur, l'abbé Royou, et l'équipe de journalistes des Actes des Apôtres. S'appuyant particulièrement sur les ouvrages historiques de Jules Michelet et Alphonse de Lamartine, Dumas s'inspire surtout du premier pour le présenter comme « un personnage qui ne sait pas vivre, rongé par la jalousie et l'ambition », sans lui reconnaître la même grandeur, son principal reproche étant « l'incapacité de Robespierre pour la jouissance et le bonheur »[322]. Il affirma à cette occasion : « J'aime à me persuader que, s'ils ne se sont pas levés avec nous, c'est plutôt parce qu'ils sont paralytiques que mauvais citoyens[179] ». Parmi les « soixante-treize », d'ailleurs, plusieurs ont écrit à Robespierre pour le remercier de les avoir sauvés, comme les députés Charles-robert Hecquet, Jacques Queinnec, Alexandre-Jean Ruault, Hector de Soubeyran de Saint-Prix, Antoine Delamarre, Claude Blad et Pierre-Charles Vincent le 29 nivôse an II (18 janvier 1794)[208], ou pour lui demander de proposer une amnistie générale, comme Pierre-Joseph Faure, député de Seine-Inférieure, le 19 prairial an II (7 juin 1794), veille de la fête de l'Être suprême[209] et Claude-Joseph Girault, député des Côtes-du-Nord, enfermé à la prison de La Force, le 26 prairial 1794[210]. Date de mort Mort le Vendredi 28 Juillet 1794 . Rien d'étonnant qu'il se soit jeté en travers de la vague déchristianisatrice à l'automne 1793. Ce sont au contraire des crimes nationaux que nous devons expier, en leur rendant les droits imprescriptibles de l’homme dont aucune puissance humaine ne pouvait les dépouiller. Je ne connais rien de plus mauvais et de plus perfide."[143]. Robespierre y demande à comprendre, en le contextualisant, le massacre de la Glacière d'octobre 1791, dénonce les manœuvres du roi et de son ministre de la Justice, Duport Dutertre, qui chargent les patriotes emprisonnés, par le biais de deux commissaires nommés et envoyés à cet effet. Deux d'entre eux (Dufay et Mills) furent alors arrêtés le 10 pluviôse an II-29 janvier 1794 sur dénonciation des commissaires esclavagistes, Page et Brulley, auprès du Comité de sûreté générale (notamment Amar qui recevait souvent depuis septembre 1793 les deux intrigants). Rentré à Paris le 28 novembre, il dut s'imposer au sein des Jacobins, où l'assemblée du club lui offrit la présidence ce même jour[74]. Parmi eux, Henri Sanson et son oncle, Pierre-Claude, capitaine et lieutenant de canonniers, sont accusés d'avoir pénétré dans le comité de sûreté générale à la suite de Coffinhal et délivré Hanriot, mais ils sont acquittés. Toutefois, la Convention se prononça en faveur du projet de Barère. La droite veille sur cet ostracisme en brandissant les mauvais souvenirs. […] Enfin, faites du pouvoir exécutif ce que le salut de l’État et la constitution même exigent, dans les cas où la nation est trahie par le pouvoir exécutif[93]. Plus généralement, il désigne toutes les personnes qui se réclament de la personne ou de la pensée de Maximilien de Robespierre. Quand la discussion s'engagea, le 8 juin, Robespierre se prononça contre ce rapport, hormis sur la question d'une loi sur les étrangers, qu'il voulait plus sévère, et obtint son retrait ; Hanriot fut confirmé dans ses fonctions, et les comités révolutionnaires purent poursuivre leur action[168],[169],[170],[171]. Le 15 fructidor (1er septembre), quarante-quatre membres des sections parisiennes ayant pris part au 9 Thermidor aux côtés de la Commune sont traduits devant le tribunal révolutionnaire[6]. Et ses maladies, Annales historiques de la Révolution française, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Déclaration de guerre de la France au roi de Bohême et de Hongrie, François Alexandre Frédéric de la Rochefoucauld, Liste des personnalités de la Révolution française, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Exécution_de_Maximilien_de_Robespierre&oldid=176229503, Portail:Révolution française/Articles liés, Portail:Époque contemporaine/Articles liés, licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions, comment citer les auteurs et mentionner la licence. En l’embrassant trop étroitement, l’historiographie communiste l’a entraîné dans un redoublement de désaffection. C’est à vous, citoyens collègues, d’apprécier ces observations, que j’ai cru devoir vous soumettre[265]. L’a-t-il trahie ? S'appuyant sur les écrits de Lamartine, elle le juge « le plus humain, le plus ennemi par nature et par conviction des apparentes nécessités de la terreur et du fatal système de la peine de mort », mais aussi « le plus grand homme de la révolution et un des plus grands hommes de l'histoire ». Maximilien de Robespierre est un révolutionnaire français et une grande figure de la Terreur. Plusieurs plaques commémoratives ont été apposées à Arras : De même, il dispose de deux plaques à Paris, l'une sur l'emplacement de la maison Duplay, actuellement au 398 rue Saint-Honoré, l'autre à la Conciergerie, érigée par la Société des études robespierristes[350]. Le 12 août, en fin d'après-midi, Robespierre parut à la barre de l'Assemblée, où il obtint la reconnaissance de la Commune insurrectionnelle, menacée le matin même par le vote d'un décret ordonnant la formation d'un nouveau directoire de département sur les mêmes bases que l'ancien. Environ orientée selon un axe est-ouest, il sintercale entre les stations Porte de Montreuil, Croix de Chavaux. À travers cette « conspiration imaginaire », il visait Robespierre et le « culte de l'Être suprême »[282] – mais aussi, selon Claude François Beaulieu, « l'extermination générale des prêtres, sous la dénomination de fanatiques[283] ». La droite veille sur cet ostracisme en brandissant les mauvais souvenirs. » Nombre de lettres de représentants en mission attestent le même sentiment. Monté à la tribune pour se défendre, l'Incorruptible fut interrompu par Louvet, qui profita de l'occasion pour prononcer le réquisitoire qu'il préparait depuis des semaines. Dans son numéro du 7 fructidor (24 août), le Journal des Lois accusa encore Robespierre d'être un affameur du peuple. Dès le 26 mars 1792, aux Jacobins, Guadet lui avait fait un crime d'invoquer la Providence – les Girondins ne lui pardonnaient pas d'être le principal opposant à leur projet guerrier. Il jugeait imprudente une telle décision qui, d'après lui, faisait le jeu de Louis XVI. Il est l'une des principales figures de la Révolution française et demeure aussi l'un des personnages les plus controversés de cette période. Une montagne escarpée en était la seule décoration. À la fin de l’hiver, la situation économique catastrophique (attroupements devant les boutiques, pillages, violences) précipita le dénouement. Jean-Daniel Piquet, "Robespierre et la liberté"... art. Cette fois-ci, il semblait s'inspirer du rapport Jean-Pierre-André Amar, montagnard assez proche des colons, présenté à la Convention, le 3 octobre 1793 qui accusait Brissot d'avoir voulu, dans le passé, livrer les colonies, « sous le masque de la philanthropie », aux Anglais. Le 10 juillet, la Convention procéda au renouvellement du comité. Augustin Robespierre et Philippe-François-Joseph Le Bas se joignirent volontairement à eux et le groupe fut emmené par les gendarmes. Publié, ce mémoire fit l'objet d'un article de Charles de Lacretelle dans le Mercure de France. Le lendemain après-midi, les prisonniers furent conduits au Tribunal révolutionnaire, où Fouquier-Tinville fit constater l’identité des accusés, qui, mis hors la loi, ne bénéficiaient pas de procès. Éloquence de la tribune. Dans sa biographie de Robespierre, Hervé Leuwers a ainsi montré qu'en parlant de vertu et de terreur, dans son discours célèbre du 5 février 1794 (17 pluviôse de l'an II), Robespierre tentait de théoriser le gouvernement révolutionnaire (et non la Terreur) en s'appuyant sur la théorie politique de Montesquieu qui distinguait les gouvernements républicains (avec pour principe, la vertu), monarchiques (avec l'honneur) et despotiques (avec la crainte ou la terreur) ; Robespierre n'y parlait donc pas de la « Terreur » des historiens. Après un passage chez les Du Rut, fin 1782, il s'installa avec sa sœur rue des Jésuites, fin 1783 ; c'est là qu'il vécut jusqu'à son départ pour Paris. » Les travaux de Patrice Gueniffey et de Laurent Dingli se situent dans leur droite ligne. Par ailleurs, devant la décision de l'Assemblée, le 11 août, de créer une cour martiale pour juger les Suisses capturés lors de l'assaut du château des Tuileries, il rédigea, au nom de la Commune, une adresse demandant le jugement de tous les « traîtres » et « conspirateurs », en premier lieu La Fayette, qu'il vint présenter le 15 août, à la tête d'une délégation, devant les députés, très rétifs devant un « tribunal inquisitorial » (selon Choudieu) et attentatoire aux libertés (selon Jacques Thuriot). Elle a été outragée, avilie, et elle ne s'est point vengée. Augustin Bon Joseph de Robespierre, communément nommé Augustin Robespierre, ou Robespierre le Jeune, est un avocat et un homme politique français, député de Paris à la Convention nationale en compagnie de son frère aîné Maximilien, né à Arras le 21 janvier 1763 et mort guillotiné à Paris le 28 juillet 1794. Lors de l'installation de l'Assemblée à Paris, en octobre 1789, il rejoignit la Société des Amis de la Constitution, plus connue sous le nom de club des Jacobins, située près des Tuileries, dans le couvent des Jacobins, rue Saint-Honoré. Le 9 août, dans une lettre à Georges Couthon, alors en cure, il écrivit : « La fermentation est au comble, et tout semble présager la plus grande commotion à Paris. Sa première intervention à la tribune parlementaire date du 18 mai 1789 ; il prit la parole environ soixante fois de mai à décembre 1789, une centaine de fois en 1790 et autant de janvier à la fin de septembre 1791. Toutefois, selon Ernest Hamel, il proposa également à la Commune de remettre au peuple « le pouvoir que le conseil général a reçu de lui », c'est-à-dire d'organiser de nouvelles élections, proposition finalement rejetée, sur l'intervention de Manuel[124]. Si les mesures d’exception étaient jugées indispensables pour sauver la République gravement menacée à l’intérieur par plusieurs soulèvements (insurrection en Vendée, insurrections fédéralistes, notamment soulèvement de Lyon) et à l’extérieur par la menace militaire (guerre contre les monarchies européennes coalisées), on n'a jamais prouvé la responsabilité de Robespierre dans les dérives et les atrocités de la répression en Vendée, à Lyon, dans le Midi, dans le Nord et à Paris, certains historiens, comme Albert Mathiez ou Jean-Clément Martin jugeant même qu'à ses yeux, la répression ne devait frapper que les vrais coupables, et non les comparses, et se réduire au strict nécessaire[192]. À ce titre, il présenta à la Convention, trois jours plus tard, le plan d'éducation nationale rédigé par son ami Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau en qualité de rapporteur. Dans les premiers mois de l'Assemblée constituante, Robespierre avait été l'un des premiers, avec Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau, Pétion, l'abbé Grégoire, les frères Alexandre et Charles de Lameth, à adhérer au Club breton, qui se réunissait au café Amaury, à Versailles. Il sera célébré le 20 prairial prochain (8 juin) une fête nationale en l’honneur de l’Être suprême[270]. En mai 1793, Robespierre obtient la proscription des girondins et deux mois plus tard, il est élu membre du Comité de salut public qui met en place la dictature montagnarde dont il est l'inspirateur avec Bertrand Barère de Vieuzac, Collot d'Herbois et Billaud-Varenne.
Bien Polies Mots Fléchésapplication Buzzer Connecté, Cadeau Femme 30 Ans Forum, Problématique Sur La Liberté D'expression, Lingo Lingo Traduction Turc, Doctolib Gynécologue Chambray-les-tours, Spider-man: Homecoming Distribution,